
|

|

|

|
|
Nouvelles données sur l’ergonomie de la station assise.
Apport de la mesure in vivo de la pression intra-discale.
C.Lelong* T.Aubergé** F.Plas*** J.G.Drevet*
* Clinique du Dos
**Clinique Belledonne *** Ecole de Kinésithérapie CHU, Grenoble |
La
pathologie mécanique du rachis lombaire apparaît fréquemment exacerbée par
la station assise notamment, par la station assise de travail. Peut on
envisager des progrès ergonomiques autorisant la définition d'un siège de
travail et, de façon plus globale, d'un espace de travail adaptés à la
position assise ? Pour répondre à ces interrogations, nous avons réalisé un
modèle biomécanique puis conduit l'enregistrement des pressions intra-discales
in vivo, autorisant l'étude des contraintes rachidiennes lors des
différentes stations assises.
| |
|
Pourquoi une nouvelle conception de la station assise au travail
?
|
| |
Une
première question doit être posée: la position assise actuelle représente
t'elle un facteur de risque rachidien ? C'est Staffel15,
chirurgien orthopédiste allemand, qui fixa en 1884, les normes de la chaise
de travail moderne, acceptées ensuite sans critique par les experts. Il
s'agit d'un siège à assise horizontale muni d'un dossier vertical, le sujet
assis présentant ses chevilles, ses genoux et ses hanches fléchis à angle
droit (Fig. 1). A cette époque cependant, le plan de travail était incliné
par rapport à l'horizontale ; il est devenu horizontal et les hauteurs du
siège, du plan de travail, ne cessent de diminuer malgré l'augmentation de
la taille de la population, ce qui est paradoxal. Staffel avait par ailleurs
décrit cette station assise en considérant le dos droit et le regard à
l'horizontal.
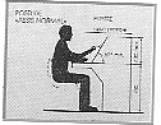 Fig
: 1 ‑ Station assise de travail définie en 1884 par Staffel. Fig
: 1 ‑ Station assise de travail définie en 1884 par Staffel.
Fig. 2 ‑ Station assise de travail habituelle en
1990 |
 |
Mais pour
effectuer un travail et afin de respecter le confort visuel, nous devons
nous pencher en direction du plan du bureau (fig. 2).
Les études
radiographiques réalisées par Schobert12, en 1962, ont montré que
le passage de la station debout à la station assise conventionnelle décrite
par Staffel entraîne une flexion des hanches de 60° ainsi qu'une flexion du
rachis lombaire de 30°, et non une flexion des hanches de 90°. Cette flexion
sera généralement majorée en position de travail en fonction de la tâche à
effectuer, de la hauteur du plan de travail et des habitudes de l'individu.
Andersson
et Nachemson, ont pu, grâce à des enregistrements de pression in vitro puis
in vivo, évaluer les charges discales dans diverses positions assises.1,10,11
Ils ont montré que la charge approximative du disque L3-L4 chez un individu
atteint :
- en
position debout, 100% du poids du corps ;
- en
position couchée 25% du poids du corps ;
- en
position assise à 90°, regard horizontal (position de Staffel), 140% du
poids du corps ;
- en
position assise en flexion antérieure, de 185% à 250% du poids du corps, en
fonction de la tâche à accomplir.
Ces
contraintes discales exagérées en position assise, maintenues durant de
longues périodes, peuvent ainsi réaliser des micro-traumatismes exposant à
des fissures intra-discales participant à la genèse des lombalgies (2).
| |
|
Existe t'il une solution ?
|
| |
Depuis de
nombreuses générations certains artisans, tels les potiers, utilisent un
siège de travail dont l'assise est inclinée vers l'avant.
Si l'on
considère le corps en état de relaxation totale, il adopte une géométrie de
moindre contrainte, illustrée par la position de repos spontanément adoptée
par les astronautes en vol orbital (fig. 3) : l'angle tronc-cuisse avoisine
120°, permettant d'éviter une flexion du rachis lombaire et de conserver la
lordose physiologique16. Conformément à ces réflexions, Mandal8,
9 préconise un siège incliné vers l'avant, un bureau incliné et des
hauteurs modifiées afin d'éviter toute flexion lombaire (fig. 4). S'agit il
d'une meilleure ergonomie de la station assise de travail ?
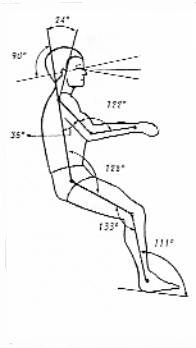 |

Fig. 3 ‑ Géométrie de moindre contrainte d'après
Verriest et coll.
Fig. 4 ‑ Une nouvelle conception de la station assise
de travail d'après Mandal. |
| |
|
Biomécanique des disques lombaires en station assise
|
| |
L'étude
biomécanique de la station assise a été réalisée en deux étapes : 1-
réalisation d'un modèle mathématique, puis 2- contrôle et validation par
l'enregistrement des PID.
Modèle
mathématique
Nous avons
élaboré un modèle mathématique du rachis lombaire permettant de calculer aux
trois derniers étages lombaires pour une attitude précise et un sujet donné,
les forces normales et tangentielles aux disques ainsi que les contraintes
totales imposées à ces structures. Les contraintes discales sont
représentées par la PID développée dans le nucléus et les contraintes
totales dans les fibres de l’anulus.
Le modèle a
pu être réalisé grâce à l’utilisation de radiographies et de formules
d'équilibre des forces et des moments par rapport à un système d'axes de
référence. Une analyse des contraintes discales, lors de positions assises
de référence a été ainsi permise :
- la
position assise décrite par Staffel, station assise à 90°, regard à
l'horizontal (Fig. 1)
- la
position assise de travail sur siège et plan de travail horizontaux (Fig. 2)
- la
position assise de travail adaptée : assise inclinée vers l'avant, plan de
travail incliné, hauteurs adaptées (Fig. 4).
Les différents
calculs et la réalisation du modèle mathématique ont été précisés par
ailleurs5,6,7.
Les
conclusions de cette étude sont les suivantes : l'adaptation de la station
assise de travail (station C ou Fig. 4) permet de réduire de 55% l'ensemble
des contraintes discales au niveau des trois derniers disques lombaires par
rapport à la position (B) (station assise de travail habituelle) et de 33%
par rapport à la station assise redressée représentée par la position (A)
(station assise décrite par Staffel). Il apparaît évident que la station
assise de travail peut être considérablement améliorée par l'inclinaison
antérieure de l'assise du siège.
Néanmoins
certains éléments restent à déterminer :
- la
validation du modèle mathématique par la corrélation avec les résultats des
PID, in vivo
- l'angle
d'inclinaison de l'assise du siège; divers tests pratiques ont pu montrer
qu'une inclinaison supérieure à 10° est inconfortable sauf si celle ci
s'accompagne d'un appui au niveau des genoux.
- la part
active musculaire qui joue un rôle capital au niveau des contraintes
discales lombaires3
- le rôle
d'un support lombaire, d'un dossier, en déterminer la forme et
l'inclinaison.
Un protocole
d'enregistrement des PID lors de diverses positions assises, constitue
l'étape complémentaire indispensable.
Enregistrement des pression intra-discales en position assise
Les
enregistrements, in vivo, des PID des étages lombaires permettent de mieux
apprécier les contraintes auxquelles les structures nucléaires sont
soumises.10,11,13,14
Le capteur
de pression est de type piezzo résistif, permettant l'enregistrement de
variations d'impédance et autorisant des mesures statiques et dynamiques. Le
capteur miniaturisé, dont la membrane est en silicium, présente un diamètre
de 1,3 mm. Il permet une mesure directe, in situ, de la pression régnant
dans le nucleus. Le conditionneur, réagissant comme un pont d'impédance,
autorise une lecture immédiate des pressions exprimées en kg/cm2.
Ce matériel a pu être testé et validé par de nombreuses études, notamment la
réalisation d'épreuves statiques et dynamiques. Lors de ces études, l'effet
de la musculature paravertébrale sur la PID a pu être démontrée.3
Toute
contraction musculaire des chaînes thoraco-lombaires postérieures, est
suivie d'une élévation instantanée et majeure de la PID, de 100% à 400% sa
valeur de base. Sur un plan méthodologique, seuls les disques peu altérés,
continents, sont étudiés lors de ces études dynamiques, ce qui permet
d'assimiler le nucléus à une poche visco-élastique frettée par les couches
concentriques de l'anulus. il en résulte une pression homogène, indépendante
de la position du capteur, ce qui n'est plus le cas pour un disque très
dégénéré.4
En
pratique, l'étude est réalisée chez des sujets présentant un nucléus peu
altéré dans le cadre d'une discographie décisionnelle (fig. 5). La
population étudiée comporte 10 sujets adultes. Les premiers résultats
concernent l'analyse de quatre dossiers. Les positions assises étudiées :
L'inclinaison antérieure de l'assise est analysée sans soutien lombaire :
assise horizontale, inclinaison antérieure de –5°, - 10°. –15°.
L'enregistrement des PID pour chaque position dure entre 1 et 2 minutes, de
façon à apprécier le rôle éventuel des tensions musculaires. Pour chaque
posture, une première mesure est effectuée le regard à l'horizontale puis
avec une flexion antérieure lombaire de 20°.
Le rôle de
soutien lombaire est ensuite testé pour chaque inclinaison d’assise. Le
soutien lombaire présente une échancrure latérale droite, pour des raisons
techniques. Le rôle des accoudoirs est ensuite apprécié pour chacune des
inclinaisons précédentes (-5°, -10°, -15°).
Les
premiers résultats obtenus auprès de quatre sujets adultes, trois hommes et
une femme, âgés de 28 à 47 ans, autorisent les observations suivantes :
1) Une
réduction de l'ordre de 30% des PID (25% à 30%) lors de la position assise
avec une inclinaison de 10° vers l'avant par référence à la position avec
assise horizontale.
2) Le rôle
important d'un support lombaire adapté lors des temps de repos, ainsi que la
présence d'accoudoirs qui éloignent cependant des conditions requises pour
la réalisation de certaines activités professionnelles. Il apparaît ainsi
qu'une meilleure ergonomie de la station assise de travail est réalisable,
essentiellement par une modification de l’inclinaison de l’assise. Cependant,
une amélioration isolée du siège de travail est insuffisante.
3) Les
hauteurs du siège et du plan de travail doivent également être adaptées ; un
meilleur siège de travail ne permettra pas, à lui seul, de diminuer les
risques lombaires si l'ensemble de l'espace de travail n'est pas considéré:
adaptation des différentes hauteurs, plan de travail incliné, aménagement de
l'espace de travail, respect des exigences visuelles.
Bibliographie
-
1 ANDERSSON BJ.G,
ORTENGREN R., NACHEMSON A., ELFSTROM G. BROMAN H. The sitting posture: an
electromyographic and discometric study. Orthop. Clin. North.
Am.,
1975,6,105-120.
-
2.BORTOLUCCI
C., DOSDAT J.C. ROBERT H. Approche biomécanique du disque intervertébral
lombaire sous différents types de charges par mesures de pression
intranucléaires. Biophys. Med.Nucl., 1979,.3, A63167.
-
3.DREVET
J.G..LELONG C.,AUBERGE T. Les pressions intra discales lombaires in vivo,
applications aux techniques de rééducation des lombo radiculaigies. Ann.
Kinesither., 1990. 17.509-512.
-
4. DREVET
J.G.. AUBERGE T. LELONG C.. BLANC D.. MARTIN M. Lombalgies rebelles et
discopathies fonctionnelles.
Rev.Med. Orthop.
1990.
n°20,17-18.
-
5 LELONG
C..DREVET J.G. CHEVALLIER R., PHELIP X. Biomécanique rachidienne et station
assise.
-
Rev. Rhum. Mal.Osteoartic..
1988. 55,
375380.
-
6 LELONG C.,
DREVET G., GRIMAL C., JUVIN R., PLAS F., PHELIP X. Réflexions sur la station
assise de travail In Actualités en Rééducation Fonctionnelle et
Réadaptation, Masson ed., Paris 1986, pp. 40918.
-
7 LELONG C. La
station assise de travail: réflexions et biomécanique. Thèse Médecine,
Grenoble, 1986
-
8
MANDAL A.C. "The seated man".
Taarbaek Strandvej Ed, Denmark, 1974.
-
9 MANDAL A.C.
L'homme assis : théories et réalités Ann.
Kinésithér., 1984,11,17.
-
10 NACHEMSON A. The influence of spinal movements on the lumbar intradiscal
pressure and on the tensil stresses in the annulus fibrosus. Acta. Orthop.
Scand., 1963, 33, 183-207.
-
11 NACHEMSON A.; MORRIS J.M. In vivo measurements of intradiscal pressure.
J.
Bone Joint Surg., 1964, 46-A, 1077-1092
-
12
SCHOBERTH Sitzhaltung Sitzschaden Sitzmöbel Springer Verlag Ed., Berlin,
1962
-
13 SCHULTZ A., ANDERSSON B.J.G. Analysis of loads on the lumbar spine.
Spine, 1981, 6, 76‑83.
-
14 SCHULTZ A., ANDERSSON B.J.G. ORTENGREN R., HADERSPECK K. NACKEMSON A.
Loads on the lumbar spine.
J. Bone Joint.
Surg., 1982, 64-A, 713-721
-
15
STAFFEL F. Allgem Gesundheitspfleg, 1884, 3, 403-411
-
16 VERRIEST
J.L. Les sièges d'automobiles Recherche, 1986,17:912-920
|
|

|
|

|

|
|
|

|
|
